Faut-il raser l'Acropole ?
Paru dans l'Atelier du Roman n° 73
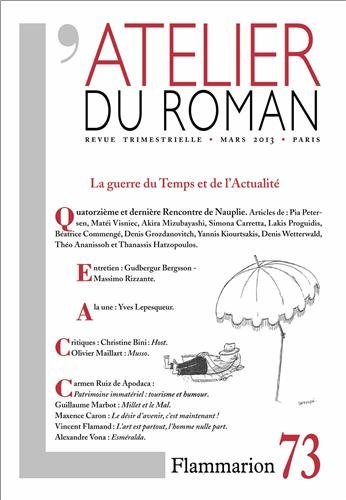
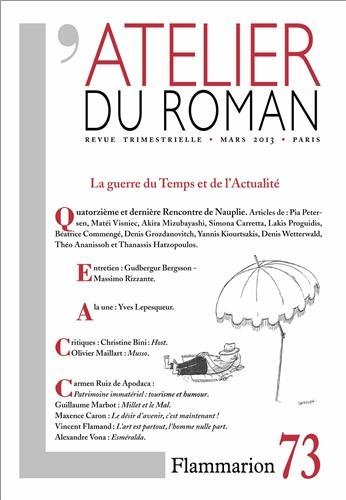
L’homme mène depuis toujours une lutte contre le temps qui passe, il ne veut pas mourir, le temps l’angoisse et il le divise en un avant, un pendant et un après, il invente des temps différents, tantôt linéaires, tantôt cycliques, temps vécu, temps scientifique, économique, naturel, virtuel, poétique, romanesque, ce sont des rythmes différents.
Le temps est une réalité objective ressentie comme subjective, il est vécu et défini en fonction de l’histoire et de la structure de la société.
Pour évoquer notre époque, je me rends compte que je ne dis plus le monde d’aujourd’hui mais notre actualité d’aujourd’hui. Il faut dire que le monde a beaucoup changé, on peut même dire qu’on a changé fondamentalement de monde.
Le monde est en perte d’humanité, la société se déshumanise, mute en système, le calcul rationnel s’impose comme seule possibilité de gestion du monde. La vitesse augmente, les repères chronologiques disparaissent dans la confusion des nouveaux temps, on découvre le temps à la fois compressé et infini. L’espace explose, les repères géographiques ne correspondent plus à la réalité, on découvre qu’on peut être partout en même temps. L’économie se mondialise, la spéculation ne connaît plus de règles et, pire que tout, l’homme se demande si c’est la fin du monde, il ne sait plus où est sa place.
Infiniment petit dans un système devenu trop complexe, l’homme semble lâcher prise à cause d’une idée d’impuissance qui est nourrie par... son actualité.
Une rupture s’est opérée dans les années quatre-vingt, au moment où l’informatique a intégré les foyers, le passage brut d’un monde à un autre, un changement de paradigme provoqué par un changement de perception: la manière dont l’homme se perçoit a été bouleversée. D’humain dans une société qui aspirait malgré tout au confort de chacun, l’homme est devenu un vecteur économique dans un système dont l’obsession est de consolider son propre pouvoir. Des questions de fond s’en dégagent. Quelle est désormais la place de l’être humain dans la société (ou le système) qu’il s’est créé? En a-t-il encore une? Quelle est sa valeur? Comment gère-t-il le fait d’être devenu inutile à son propre monde?
La création, l’art, la littérature ont subi aussi ces bouleversements. Il n’y a pas si longtemps, nous avions en commun un socle sur lequel on pouvait s’appuyer pour penser plus profondément, plus loin et qui aidait à poser les questions auxquelles aucun être humain ne peut échapper. Qui suis-je, où vais-je, pourquoi suis-je là? Aujourd’hui il n’est plus question de temps de création, de réflexion ou de temps critique. Il s’agit d’être rentable et efficace, savoir amuser, on recherche le plaisir, la jouissance, et le reste on s’en fiche. En littérature, la création est passée de la dimension spirituelle (qui nomme) à la fabrication de scénarios (qui produit), elle a perdu en partie la place qu’elle occupait en tant que créatrice de mythes fondateurs. Soumise aux lois économiques de l’édition et aux appréciations des lecteurs, la création romanesque ne peut plus s’exercer librement. On pourrait dire que tant pis, de toute façon elle ne cherchait plus à s’exercer dans ces directions-là. Aux prises avec le blues, un grand et immense spleen, la création littéraire dit qu’elle n’est plus utile à quoi que ce soit. Un blues mondialisé... Être utile ou ne pas être.
Devenir un simple vecteur économique, purgé de toute humanité, ça craint, surtout quand on n’en est pas tout à fait conscient. Afin de faire face aux peurs que déclenche ce changement de monde, le retour vers le passé (repère, refuge) est de plus en plus massif. On cherche à mettre un frein au progrès, à revenir en arrière, à retrouver une manière biologique de vivre. On ne veut plus des chaînes de fast-food mais retourner chez Claude qui fait passer ses surgelés pour de la cuisine familiale. Partout sur la planète, on s’accroche à ce qu’était le monde autrefois, à ce que nous connaissons.
Pour trouver une solution à nos problèmes, on cherche dans le passé qui, dit-on, contient toutes les clés. On pense, analyse en fonction de et avec le langage du passé. On dit qu’il faut résister, peut-être même reculer sur la mondialisation, sur l’Europe, qu’il faut chasser les mots étrangers qui se glissent dans chaque langue pour revenir à l’idée d’un dialecte pur. En anglais, exit les mots français. En français, exit les mots anglais. À chacun sa langue. On veut retrouver une possibilité d’humanité avant qu’il ne soit trop tard. Mais comment faire ? Ralentir le progrès ? On aimerait se diriger un jour vers une démocratie comme l’avaient conçue les Grecs, seulement ce qui est, est.
Modifier des éléments isolés d’une société est a priori possible. On aurait réagi plus tôt en analysant à temps l’impact de l’informatique, le monde aurait pu être différent. La crise économique n’était pas inéluctable ni obligatoire. Mais on est dans un système où tous les éléments sont interdépendants, liés. Un pays pourrait-il aujourd’hui s’extraire de la mondialisation, s’isoler comme l’avait fait la Chine à une époque? Les conséquences seraient inimaginables. Que faire alors? Peut-être faut-il revenir à une vue d’ensemble, ne pas s’obstiner à raisonner en partant d’un pays mais en considérant qu’il y a une planète et des gens sur cette planète. Seulement, bien que tout soit lié, on ne sait plus voir ces liens, on ne voit plus à quoi ils servent, on n’arrive d’ailleurs plus à lier les choses entre elles puisque nous ne savons plus discerner.
Puis est-ce en creusant dans le passé qu’il faut réfléchir aujourd’hui ? Avec 1984 ou Le Meilleur des mondes et d’autres œuvres dystopiques, on a bien vu l’importance du passé, ce n’est pas contestable. Sans passé, il ne peut y avoir un présent, ni même un avenir. Sans passé, il n’y a plus de temps. Le passé, c’est une mise en perspective de l’histoire de l’humanité qui nous permet de penser le présent, le comprendre, le comparer et de réagir quant à la réécriture révisionniste du passé. On est donc dans une impasse. Pourtant il y a une urgence, l’état du monde, qui nécessite la mise entre parenthèses du passé pour penser aujourd’hui car des problèmes d’autrefois sont maintenus en tant que problèmes actifs dont il faut se préoccuper et qui conduisent à la dispersion des matières grises. Il n’est pas question de raser l’Acropole ni d’occulter le passé mais s’il faut penser aujourd’hui, ce qu’est et ce que sera le monde, il faut peut-être écarter l’influence du passé un moment.
Les médias sont des passeurs d’actualités et celles-ci sont choisies en fonction de leurs intérêts politiques, économiques. En tant que consommateur, il faut être informé, tout savoir. L’actualité est devenue un flux d’informations sur ce qui se déroule en continu, elle prend en otage notre attention et nous maintient dans un présent perpétuellement actuel et ce présent fonctionne à une vitesse sans cesse augmentée. Ainsi, le temps s’annule: sous cette avalanche, une info en chasse une autre, on ne sait plus où on en est. Ce temps médiatique qui superpose les événements pulvérise le temps de réflexion et de recul et le nivelle par la vitesse. On devient léthargique et passif, l’homme perd sa capacité à discerner les temps/les éléments. Il devient en effet de plus en plus actuel, ballotté entre toutes les réalités qui s’imposent à lui. Un crash d’avion qui s’est produit hier n’existe plus aujourd’hui. Le présent n’entre pas en mémoire, la mémoire vive du passé immédiat ou proche n’existe plus au-delà de quelques jours, seule existe la mémoire historique. L’homme perd sa mémoire instantanée, son fil conducteur, sa capacité à relier les éléments. La pensée fonctionne désormais par fragments et ces fragments sont désordonnés, au lieu de penser nous zappons/nous vivons en mode zapping. On ne pense plus en continu mais peut-on penser par fragments?
Si l’on ne lie pas les choses, les événements entre eux, si l’on ne peut les discerner, comment arriver à une vue d’ensemble qui permette de penser?
Le passeur d’information détient un pouvoir, il manipule le temps et la vitesse et il a la capacité de créer la réalité par l’actualité qu’il nous fournit. Il nous montre une émeute dans une rue à Paris à un moment précis mais, ailleurs dans le monde, on voit que Paris donc la France est en guerre. Cette réalité créée par l’actualité n’est pas vérifiée par ceux qui la reçoivent mais acceptée sans remise en question.
C’est la fin de l’esprit critique car comment penser quand on ne peut plus poser un problème dans son ensemble, en avoir une vision globale quand le temps pour le faire n’est plus? On ne crée plus de lien entre les informations, on ne pense plus au-delà de soi et, sans la capacité de créer des liens, on reste coincé dans un problème isolé, dans une particularité, dans tout ce qui se rattache à son propre monde. Les petits faits prennent le pas sur les grands événements.
Nous sommes tellement préoccupés par le passé, que les problèmes du présent sont déterminés principalement par les médias, qui non seulement ne savent pas quoi en faire mais qui, en plus, tuent le temps en créant une réalité aléatoire.
Comment penser notre avenir quand les définitions de nos concepts fondamentaux sont antidatées? Le passé étant en augmentation, réfléchir en fonction du passé exige un temps très long, alourdi et encombré par ce poids, on peut ne jamais s’en extraire et tant pis pour notre avenir.
Il est à la mode de dire que le nouveau n’existe plus, désormais on fait des collages avec ce qui est. On n’est plus dans la construction mais dans l’aménagement ou la rénovation. Exit donc la possibilité de nouvelles approches car comment aller vers autre chose quand le nouveau n’est plus possible? Pourtant nous n’avons plus ni temps ni espace et notre perception de la réalité est plutôt virtuelle. Il y a pas mal d’inédits.
Nous n’avons pas encore défini notre présent qui dépasse notre langage et cela pose un gros problème pour comprendre et prendre les bonnes décisions pour demain. Nous sommes dans une impasse à cause de nos concepts antidatés, nous sommes décalés de l’époque où nous vivons, coincés dans ce décalage entre notre réel et nos moyens pour le dire. Pour en sortir, il faut un travail de définition, un chantier qui exige qu’on mette entre parenthèses, pour un temps, le passé afin de se concentrer sur l’avenir. Il faut ajouter aux concepts déjà existants ce qui leur manque, à savoir la réalité présente. Qu’est-ce que le travail: une nécessité morale ou une question de survie? Et le bien, et le temps?
Il y a des inédits que nous ne pouvons pas penser avec le passé: le changement de monde provient de la vision que l’homme a de lui- même, autrefois il se voyait au travers de son désir d’humanité, aujourd’hui il se voit au travers de l’économie. Sa perception, son angle de vue ont changé et cela transforme radicalement le sens de nos définitions. L’euthanasie est en voie de légalisation mais le discours pour la légalisation de la mise à mort d’une personne est-il le même dans une société fondée sur son humanité ou dans une société fondée sur l’économie?
Alors, doit-on chercher dans le passé? Si l’on dispose de moins de temps, s’il faut suivre le rythme, comment faire? Faut-il être sans temps fixe? Se mettre hors temps? Oui, comment se battre? Le changement de monde est radical et s’opère dans sa globalité. On ne peut pas analyser ces effets uniquement par secteur. Ce sont les fondements qui ont changé, la manière dont on les interprète. On n’est pas dans une société mais dans un système où tout est interdépendant, tout est lié, il est impossible de retourner vers le passé et défaire ce qui est. Pourquoi ne pas commencer par redéfinir ces fondements? Reprendre les concepts: guerre, bien et mal, travail, sens de la vie, justice, liberté, surtout la liberté... Nous vivons avec ces nouvelles définitions qui se redéfinissent d’ailleurs tous les jours. La réalité est mais n’est pas nommée. Existe ce qui a été nommé. Tant que ces nouvelles définitions des concepts ne sont pas écrites, elles n’existent pas. Seulement, qui s’occuperait à redéfinir les concepts?
Puisque la vision qu’a l’homme de lui-même a changé, il ne peut plus penser le monde à moins de se voir et se comprendre en tant que vecteur économique dans un système. Comment s’affranchir de cette vision? Elle n’existe pas, n’a pas été nommée, elle ne peut donc pas être affranchie. Afin de reprendre possession de notre humanité, de notre monde, il est indispensable de procéder à de nouvelles définitions (ajouter ce qui manque, faire une remise à jour) mais il faut d’abord retrouver une vision, une perception commune. Si l’on admet qu’on est désormais dans un monde nouveau, on ouvre la possibilité de travailler de près la version/vision de ce qui est déjà.
Pour le moment, seule l’économie s’est approprié la mondialisation et elle en fait ce qu’elle veut, faute de contre-argument. Se battre pour un monde qui n’est plus, se battre contre le monde qui est, c’est se battre contre une évidence et cela prend du temps et de l’énergie. Refuser la globalisation, refuser ce qui est notre actualité, refuser ce qui est, c’est refuser aussi de reprendre en main notre vie et notre monde. Pourquoi continuer à se battre contre, en refusant ce qui est? Pourquoi rester dans une ancienne logique qui veut qu’on en passe par la table rase? Par manque de liberté d’esprit? Pourquoi ne pas accompagner la globalisation, l’analyser en remettant nos principes à jour, en reprenant possession de ce qui existe pour en faire autre chose? On ne recule pas vers le passé, on ne défait pas ce qui nous a construit, on pose ce qui est en tant que problème dans sa globalité, en s’appuyant sur des définitions qui traduisent fidèlement notre actualité.
Un problème mal posé est un problème qui n’est pas à sa juste place. Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement: Boileau.
Il ne faut peut-être pas raser l’Acropole mais il faut écarter pour un temps le passé en tant qu’idéal.
P. P.
